L'Anscoflex II
- latelierdejp

- 27 févr. 2025
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 8 mars 2025
Préambule.
J’avais prévu de rester raisonnable à la Bourse de Villers-Bretonneux. Pari dangereux quand on sait le nombre de belles choses qui s’y trouvent !
J’ai donc résisté tant que j’ai pu, mais en me baladant vers la fin de la Bourse, j’ai quand même craqué pour un appareil, disons, étonnant.
Petite négociation sympathique, pour la forme, et j’emmène ce drôle d’engin dans sa valise en cuir un peu fatiguée mais témoin du sérieux marketing de l’engin.
Un peu d’histoire.
Si vous vous intéressez un tant soit peu à l’univers de la photographie, le nom d’Ansco ne vous est pas étranger.
Cette société, américaine, a vu le jour en 1896 à Binghamton. Elle fabriquait alors du papier photographique et s’appelait Wescott Photo Specialty. Entre 1900 et 1907, elle changera plusieurs fois de nom pour arriver enfin au nom d’Ansco, la contraction des noms Anthony et Scovill, les nouveaux propriétaires.
En 1928, elle fusionne avec Agfa et devient Agfa-Ansco. Elle étoffe son offre : outre les papiers photographiques, elle fabrique du film, de la chimie pour la photographie et des appareils photo. Deux Oscars techniques la récompenseront pour ses produits en 1935 et 1937.
Outre ses propres produits, Ansco commença à revendre des appareils d’autres fabricants, re badgés ou fabriqués sous licence, essentiellement des Agfa.
En 1939 la société Agfa – Ansco fut rebaptisée General Aniline & Film (GAF). Mais en 1944, GAF disparait car Afga était une industrie allemande, reconnue prise de guerre. L’entreprise reprend son nom initial d’Ansco. Elle continue à produire du film, notamment aussi pour le cinéma, et continue à imaginer des appareils photos, généralement simples d’utilisation et d’un coût abordable.
La société reprend son essor et produit jusqu’à 2 millions d’appareils par an. A partir des années 1950, elle vend de nouveau des appareils re badgés Ansco, des boitiers fabriqués par Agfa, bien sûr, mais aussi par Chinon, Ricoh et Minolta.
En1967, re-changement de nom et elle redevient GAF : elle continue a fabriquer des films et des appareils sous sa nouvelle dénomination, GAF. Mais c’est le début de la fin : en 1977, elle ne produit plus que des films.
En 1978, la société Haking de Hong-Kong acquiert le droit d’utilisation de la marque Ansco. La fabrication des appareils Ansco sera alors poursuivie jusque dans les années 1990 par Haking, tandis que GAF devint Anitec. C’est cette dernière, en 1992, qui célèbrera le 150e anniversaire de la société. L’usine de Binghamton fut fermée en 1989 et démolie en 2000.
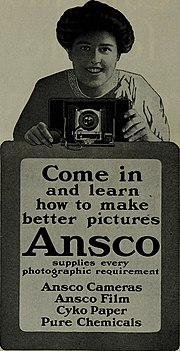
Présentation de l’Anscoflex II.
Je vous avoue que lorsque j’ai vu cet appareil, présenté debout et fermé mais flanqué de son flash (c’est ça qui m’a fait penser à un appareil photo), j’ai été surpris, tant par sa forme, qui tient plus du frigo que d’un boitier photographique, que par sa conception, toute métallique (quoique, pour un frigo !).
Si c’est un deuxième du nom, il en existe logiquement un premier.

Et cet Anscoflex I est un appareil étonnant sur le plan mécanique : un boîtier en métal émaillé d’un gris/vert avec, sur la droite (vu de dos), un énorme bouton d’avance et d’armement ; puis un petit bouton rouge métallique en saillie pour le déclenchement ; un rideau en aluminium en face avant qui protège le viseur et l’objectif ; un énorme viseur carré sur la façade et un petit rond où se loge l’objectif en dessous.
C’est tout, c’est sobre, c’est très années cinquante.
Techniquement, le lever du rideau ouvre les deux volets du dessus, qui masquent le large viseur. Ces volets sont commandés par deux petits rivets circulant dans des fentes de forme complexe à l’intérieur du rideau. Puis deux petits ressorts permettent de rabattre les volets à la fermeture. Astucieux, mais il faut y aller avec délicatesse pour ne rien déboiter, surtout si un peu d’oxydation venait à trainer par là.

A l’arrière du viseur, un bouton poussoir rouge commande l’ouverture du dos du boîtier. Le rideau dispose d’un rebord pour pouvoir le manipuler facilement.

Enfin, l’appareil est protégé contre les doubles expositions et le bouton d’avance/armement est un mouvement en va et vient quand on a compris que son quart de tour n’était pas suffisant pour faire avancer le film d’une vue !

Il n’y a pas de compteur de vue mais une simple fenêtre en plastique rouge inactinique au dos. Ici, il faudra faire attention car il faut faire un certain nombre de va et vient pour faire avancer d’une vue, sans dépasser le chiffre qui apparaîtra.

Il n’y a pas de réglages ni d’ouverture (f11 fixe) ni de vitesse (1/60s). Ce qui est amusant, c’est que le viseur est un simple ménisque alors que l’objectif composé de 2 éléments en verre. Nous devons ce bel objet au designer franco-américain Raymond Loewy. Pourtant c’était un appareil vendu à bas prix, qui était de 15,95$ au moment de sa sortie, en 1954.
L’entreprise mettra le paquet pour promouvoir son nouvel appareil, telle une pleine page dans le numéro 19 de juillet 1954 du magazine Life : … Styled by Raymond Loewy, cette toute nouvelle caméra réflexe combine la beauté intelligente avec les avancées techniques modernes et la construction robuste vêtue de métal pour vous apporter tout ce que vous avez toujours voulu dans une caméra en instantané facile à utiliser! …
Si effectivement Raymond Loewy a mis la main à la construction originale de cet appareil, la plupart des fonctionnalités (oui, je sais, le mot est peut-être trop fort) étaient déjà reprises dans un prototype Ansco de 1948, le Shurflex. Relevons quand même la construction modulaire, tout en aluminium du boitier. A cette époque, la plupart des concurrents utilisaient le plastique moulé. Une autre particularité pour un appareil de ce prix, il utilise deux éléments en verre pour l’objectif là où la concurrence utilise toujours des simples ménisques (voir le Kodak Dualflex 1 par exemple).
Donc, je résume, l’Anscoflex 1 présente un objectif en verre à 2 éléments, ouvrant à f11 fixe (mise au point minimale à 1,2m) et une vitesse fixe de 1/60s. C’est aussi ce qu’on appelle un faux TLR (twin lens reflex, appareils à objectifs superposés) car il n’y a pas de mise au point asservie à la vision du premier objectif.
La seconde itération sera-t-elle plus performante ?
En fait, … non !
Ah, on y a bien ajouté 2 commandes, sous les objectifs, mais elles ne révolutionnent rien, jugez plutôt :
le premier cercle, à droite vu de face, actionne une lentille close-up, comme sur les Polaroid plus tard. Grâce à elle, vous pourrez photographier au grand angle, mais sans préciser quel angle.
le second cercle, à gauche donc, fait glisser un filtre jaune devant l’objectif. Léger anachronisme de la chose lorsque dans ces années-là on passe progressivement à la couleur.
Et c’est tout !
Cet appareil, destiné au grand public, a bénéficié d’une campagne publicitaire importante, on trouve même des posters :
Mais nous pouvons relever quelques idées peu abouties, comme le filetage pour trépied qui sous tend une utilisation pour éviter le flou mais il n’y a pas de filetage pour un câble de déclenchement. D’autant que la vitesse restera encore et toujours au 1/60s, et que le piston qui fait bouger l’obturateur latéralement risque aussi, par sa rigidité, de provoquer ce f… flou. Ensuite le mouvement de va et vient pour armer et faire avancer le film, car il faut compter une cinquantaine de mouvements pour arriver à la première vue du film. Ce n’est pas d’une facilité exemplaire.

Tiens, je n’ai encore rien écris à propos du flash, l’Anscoflash IV. Celui-ci se fixe sur le côté gauche de l’appareil grâce à une vis et 1 tenon qui se calent dans la carrosserie. Celui-ci utilisent deux piles C classiques, qui se logent dans la poignée. Les ampoules sont soit des SF, des SM ou des M2 (grosses ampoules à douille métallique). Seul ce flash est accepté par l’appareil, comme pour les Brownie Hawkeye de Kodak.
Monté sur l’appareil, ça lui donne un petit côté reporter à la Weegee (sans la grosse SpeedGraphic et le cigare Cubain).

Quant à la synchronisation, elle se fait au … 1/60s, la seule vitesse de l’appareil.
A l’origine, l’appareil se vendait dans une mallette en cuir brun qui contenait l’Anscoflash IV, 2 piles C, 4 ampoules flash et l’appareil dans un sac tout près en cuir de la même couleur que le boitier. D’origine, la lanière en plastique, de la même couleur encore, non réglable, est fixée à l’appareil.
Un mot encore sur ce drôle d’engin : il utilise du film en 620 et impossible d’y faire entrer du 120, ça coince.
J’ai déjà expliqué la différence entre les 2 bobines, illustrées ci-dessous :

ll existe plusieurs méthodes pour faire passer du film 120 sur des bobines 620, vous en trouverez pas mal sur Internet, mais celle que j’utilise est plus rapide et plus simple : vous entourez la pellicule dans du film alimentaire bien serré puis, avec une petite ponceuse et une feuille à gros grain (180 par exemple), vous ramenez l’épaisseur de la rondelle de la 120 à celle de la 620 (1,25mm) de chaque côté. Puis vous ôtez le film alimentaire, qui aura retenu les poussières, et le tour est joué.
Que penser de cet Anscoflex 2 ?
Comme je le disais en préambule, ce boitier a un petit quelque chose qui attire le regard, surtout s’il est monté avec son flash.
Le volet à l’avant intrigue et on a envie de le soulever pour découvrir ce qui se cache derrière. Puis on aperçoit l’immense viseur en verre, très clair.

Mais bien vite on constate aussi les limites de l’engin : pas de réglages, hormis les 2 boutons devant, qui sont plus des gadgets que des accessoires utiles ; pas de vrai TLR mais c’est bien imité ; la gymnastique pour faire avancer le film à la première vue puis aux suivantes, archaïque.
Si je n’ai pas eu l’occasion de tester le Brownie Hawkeye, j’ai utilisé le Kodak Dualflex, qui date de la même époque et les résultats furent … surprenants !
Je vais donc tester cet Anscoflex, pour le plaisir. Les résultats sous peu (enfin, le temps de prendre les photos, de les faire développer et scanner).
En trouver un de nos jours en bon état et avec son box complet n’est pas évident, quoique vous en trouviez sur Ebay, mais aux USA. Sinon les prix varient de 25€ à 75€. Pas de quoi se ruiner pour tester un objet qui a su défier le temps et les modes.
Vidéos d’illustration.
Des références.
https://mikeeckman.com/2022/11/ansco-anscoflex-ii-1954/, https://www.historiccamera.com/cgi-bin/librarium2/pm.cgi?action=app_display&app=datasheet&app_id=3028, https://alysvintagecameraalley.com/2020/06/18/the-anscoflex-ii/, https://mikeeckman.com/photovintage/vintagecameras/anscoflex/index.html, https://alysvintagecameraalley.com/2020/05/30/the-anscoflex/, https://www.jeremymuddphoto.com/blog/2024/2/3/anscoflex-ii-form-over-function, https://www.flickr.com/photos/shaneblomberg/albums/72157630846801082/with/7688162570 (pour le démontage en vue de le nettoyer), en anglais ; http://www.ericconstantineau.com/photo/review_anscoflexii_fr.html, https://fr.wikipedia.org/wiki/Ansco, https://www.collection-appareils.fr/x/html/page_standard.php?id_appareil=424, en français.




Commentaires